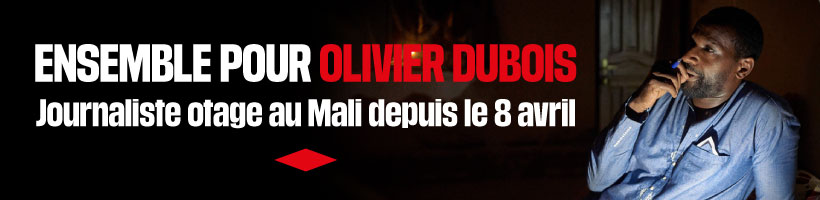«Est-ce le Bélarus qui va intégrer la Russie, ou est-ce la Russie qui va intégrer le Bélarus ? Nous ne savons pas», s’interrogeait avec sa mauvaise foi coutumière Alexandre Loukachenko le 9 août, lors d’une interminable conférence de presse, un monologue éreintant de plus de huit heures. Les choses pourraient s’éclaircir, ce jeudi. Ou pas. Le président bélarusse rencontre à Moscou Vladimir Poutine pour une énième discussion autour de la feuille de route qui encadre l’approfondissement des relations entre les deux pays, et dont le contenu n’a jamais été rendu public. Quant à savoir si elle sera cette fois bien signées, pour l’instant les informations sont contradictoires.
«Quand Alexandre Loukachenko a signé le traité d’union entre la Russie et le Bélarus, en 1999, Boris Eltsine était très affaibli, donc le président bélarusse se voyait prendre la tête du nouvel Etat, dont l’idée était de recréer l’URSS, en incluant d’autres anciennes ex-républiques soviétiques», explique le politologue Pavel Usov, qui dirige le Centre d’analyses et de prévisions politiques basé à Varsovie. Loukachenko doit finalement s’asseoir sur ses ambitions : les institutions supranationales sont créées mais le traité d’union finit dans un tiroir. «Jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, qui a vu dans l’union l’opportunité de rebâtir l’empire russe, et d’en faire une superpuissance, qui lui garantit un fort soutien en politique intérieure, précise Pavel Usov. Et, en politique extérieure, la capacité de faire pression sur l’Union européenne, en faisait du Bélarus un terrain militaire.»
En août 2020, c’est au tour d’Alexandre Loukachenko d’être très affaibli. Vladimir Poutine n’a pas attendu 24 heures après la présidentielle contestée, qui a provoqué les plus grandes manifestations de l’histoire moderne du pays, pour rappeler à son homologue qu’il était temps de transférer les pouvoirs. Ce que le dictateur bélarusse, jouant avec les nerfs du président russe, avait toujours réussi à éviter. Sous pression à l’intérieur du pays comme à l’international, Alexandre Loukachenko a plus que jamais besoin du soutien de Moscou. Mais plus le Kremlin se montre agressif, moins les Bélarusses, eux, approuvent l’union entre les deux Etats – les sondages montrent un refroidissement des sentiments pro-russes à partir de 2019, quand les négociations autour de la mystérieuse feuille de route ont commencé. Les Bélarusses, surtout les jeunes, se sont davantage tournés vers l’Occident. «Et ce, malgré la propagande d’Etat, qui martelait les avantages, surtout économiques, d’un tel rapprochement, explique Pavel Usov. Après l’été 2020, les sentiments à l’égard de l’intégration sont devenus majoritairement négatifs, même dans les régions à l’est du pays, traditionnellement favorables à la Russie.»
«Je ressens l’influence russe»
A Vitebsk, où se trouve la maison d’enfance de Marc Chagall mais aucune de ses peintures, la Russie toute proche ne fait pas vraiment rêver Tania et Sacha. Les deux adolescentes flânent dans le centre, «puisqu’il n’y a rien d’autre à faire ici». A 14 ans, Tania voit la ville se vider, «personne ne veut rester, c’est une des régions les plus pauvres du pays». Une seule destination l’intéresse en Russie, c’est Saint-Pétersbourg, parce que son grand frère y est étudiant. Quant à Sacha, 13 ans, elle sait déjà que sa vie se construira en Pologne : sa famille essaye d’obtenir la «karta polaka», un document délivré par Varsovie aux descendants de citoyens polonais pour faciliter leur immigration. «Je ressens l’influence russe, explique l’adolescente. J’accepte qu’on ait la même langue, parce qu’on est tout près, mais je ne veux pas de cette situation, je ne veux pas subir cette influence. A la maison, mon père aime parler bélarusse.»
«Je préfère encore avoir Monsieur Moustache au pouvoir qu’être russe !»
— Maria, 23 ans, interne en psychiatrie
160 km plus au sud, à Moguilev, Nadia, 22 ans, étudie à l’université bélarusse-russe, «la seule du pays dont les diplômes sont reconnus en Russie». Mais c’était un choix par défaut, l’inscription se faisant beaucoup plus tard que dans les autres universités du pays, dont Nadia avait raté la date limite. «Ma mère trouve que je devrais travailler en Russie, mais je ne veux pas. Je veux vivre au Bélarus, et bien vivre, c’est pour ça que j’étudie pour devenir programmeuse.» Elle sait qu’elle peut compter sur des parents éloignés si elle devait s’installer de l’autre côté de la frontière. Elle pourrait à la rigueur vivre à Saint-Pétersbourg, elle aussi, mais s’il fallait quitter son pays, ce serait plutôt pour le Canada. Sa grand-mère, Galina, ne se dit «pas contre» l’intégration à la Russie, où elle est née il y a plus de 70 ans, même si elle se considère bélarusse à 100%. Elle supporte le régime d’Alexandre Loukachenko, et admet une certaine nostalgie de l’Union soviétique : «Je sais bien que tout n’était pas parfait, mais nous avions le sentiment d’appartenir à un groupe.» Pour la vieille dame, «le vrai Bélarus, c’est à l’est. Ici les jeunes sont travailleurs, alors que dans l’ouest du pays, ils friment parce qu’ils sont proches de l’Europe !» C’est vrai qu’à Brest, précise Nadia, qui a passé son enfance dans cette grande ville de l’ouest à la frontière polonaise, «tout le monde est obsédé par la karta polaka».
«Plus on s’approche de la Russie, pire c’est !»
A Gomel, encore plus au sud, près des frontières russe et ukrainienne, l’idée d’une intégration terrifie Maria, qui, à 23 ans, est interne en psychiatrie. «Je préfère encore avoir Monsieur Moustache au pouvoir [elle ne veut pas prononcer le nom d’Alexandre Loukachenko, car elle a remarqué, à la terrasse du café où l’on discute, une caméra de surveillance, ndlr] qu’être russe ! Les villes russes sont sales, ils ont des taux de corruption et de criminalité très élevés, pas comme au Bélarus. La Russie est restée coincée au XXe siècle, alors que l’Union européenne est déjà au XXIIe siècle !»
Les trois capitales régionales de l’est bélarusse se ressemblent beaucoup entre elles, autant qu’aux capitales régionales de l’ouest du pays : des rues Lénine, propres et fleuries, un immense parc central (celui de Gomel est célèbre pour ses toilettes, les plus chères du pays, elles auraient coûté un million de dollars), une rivière paisible, des casinos surtout fréquentés par les Russes, car les établissements de jeux de hasards sont interdits dans la fédération voisine, des églises orthodoxes aux dômes rutilants. «Mais la différence avec l’ouest, c’est qu’ici, les jolies rues sont beaucoup moins nombreuses, explique Ivan, étudiant en médecine de 22 ans, originaire de Brest. Dès que l’on s’éloigne du centre, il n’y a plus que des barres de béton et des isbas [maisons de bois des paysans russes] qui tombent en ruine. Quand je suis arrivé à Gomel, j’ai été choqué par la pauvreté, je n’avais jamais vu autant d’alcooliques. Plus on s’approche de la Russie, pire c’est !»
A lire aussi
Mais, plus que la géopolitique, ce qui préoccupe les Bélarusses, c’est d’arrondir leurs fins de mois. Tous les mardis matin, une vingtaine de jeunes hommes s’agglutinent devant la friperie Moda Maks de Moguilev, une demi-heure avant l’ouverture. Ils viennent chercher les vêtements siglés qui arrivent d’Europe. Surnommés les chasseurs de marques, ils revendent leurs trouvailles sur Internet. «Ici, tout le monde a besoin de se faire un peu d’argent, explique Anton, 20 ans. Je sèche même les cours pour venir. Pour nous, c’est important de porter des vêtements de marque, ça nous permet d’avoir confiance en nous.» Il a acheté un short Fred Perry et une veste Ralph Lauren pour 20 dollars, et espère en tirer 75 dollars – soit, en une heure, l’équivalent d’une semaine de salaire minimum.
Ligne rouge
Pour gagner plus que les maigres revenus de Yandex Taxi (l’équivalent russe d’Uber), qu’il obtient à Moguilev, Ivan, la quarantaine, a essayé de vivre à Moscou, avant de décider de passer la moitié du temps dans sa ville natale, et l’autre moitié dans la capitale bélarusse, les courses étant nettement mieux rémunérées à Minsk. Près d’un lycée professionnel de Vitebsk, une professeur revend les créations abandonnées de ses élèves (qui n’en touchent pas un sou), des vêtements d’inspiration folklorique ou soviétique. De l’autre côté du pont, une future étudiante attend la rentrée universitaire à Minsk derrière son stand de kvas, une boisson gazeuse très populaire, pour quinze roubles (cinq euros) par jour.
Difficile de s’opposer à un projet qui n’est pas encore clairement défini, et dont les détails sont gardés secrets. «Les Bélarusses n’en ont pas tous la même idée de ce que sera l’intégration, poursuit Pavel Ursov. Certains ont peur que leur Etat soit désintégré, ou qu’il y ait une annexion. C’est très peu probable. La Russie prendra d’un seul coup le contrôle économique, politique et militaire du pays, ce qui entraînera évidemment une russification du pays et sera un désastre pour le projet national bélarusse.» Pour Maria, l’intégration à la Russie, peu importe sous quelle forme, constitue une ligne rouge pour le peuple : «Si cela se produit, nous retournerons dans la rue !» Ce qui affaiblirait encore davantage Alexandre Loukachenko face aux exigences du Kremlin.